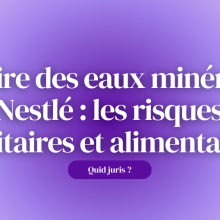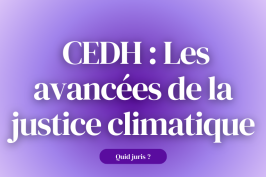Droit et justice
Affaire d’Avallon : Ce que risque la maire
Le narcotrafic s’invite dans la vie démocratique locale avec la mise en examen et l’incarcération pour trafic de stupéfiants, le 10 avril dernier, de la maire d’Avallon. Une perquisition avait permis de trouver à son domicile 70 kilos de cannabis, un kilo de cocaïne et plus de 7000 euros en espèces. Ses frères, connus de la justice, sont également mis en cause, mais on ignore encore le degré d’implication de l’édile. Pour son chef d’inculpation, la maire s’expose à vingt ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende, cette peine pouvant être allégée ou aggravée selon l’objet du trafic (importation, fabrication, transport, détention… de stupéfiants) (Code pénal, articles 222-34 et suivants). L’occasion de s’interroger sur les suites pénales et administratives à l’égard du maire.
Droit et justice
Sécurisation et régulation de l’espace numérique : une loi et après ?
Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (dit SREN) a enfin été adopté le 10 avril 2024, au terme d’une longue procédure parlementaire. Un doute demeure cependant, ou plutôt deux difficultés : une difficulté à court terme d’abord, relative à une possible censure à venir du Conseil constitutionnel. Une difficulté à moyen et long terme ensuite, intrinsèque aux difficultés de mise en œuvre technique de certaines solutions proposées.
Droit et justice
Heures de cours non remplacées : l’Etat déclaré responsable
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu, dans plusieurs affaires, la responsabilité de l’État pour carence dans l’organisation du service public de l’enseignement en raison des lacunes dans le remplacement des professeurs absents. Sont ici indemnisés les parents d’élèves pour les préjudices nés de la perte de chance de leurs enfants de réussir leurs années et cursus scolaires futurs en raison de la rupture de la continuité pédagogique (pour les collégiens qui n’ont pas bénéficié de 107 heures d’enseignements obligatoires en 2020-2021 et 39 heures en 2021-2022), et du retard pris dans l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences (pour les élèves inscrits au sein d’une école élémentaire qui ont été privés de l’intégralité des enseignements obligatoires sur une période de 30 jours).
International
La CEDH condamne la Suisse : tsunami climatique européen ou simple tempête ?
Les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 avril 2024 à propos des obligations des États en matière climatique resteront dans l’histoire ! C’est la première fois qu’une juridiction de cette importance consacre clairement une telle obligation à l’égard des États, ce qui la conduit à condamner la Suisse à la suite de la requête formée par une association « Aînées pour la protection du climat » réunissant plus de 2500 citoyennes suisses de plus de 64 ans poursuivant l’État helvète pour son inaction climatique et les effets induits sur leurs conditions de vie et de santé.
En bref
19 avril 2024
Lutte contre la criminalité organisée : Un parquet national dévolu ?
18 avril 2024
Conditions de détention dans une prison de Normandie : La CEDH condamne la France
17 avril 2024
Le Parlement suisse vote l’interdiction des symboles extrémistes
15 avril 2024
Le premier procès pénal de Donald Trump s’ouvre à New York
11 avril 2024
RIP sur l’immigration : Les Républicains voient leur demande rejetée par le Conseil constitutitonnel
Curiosis
Vous avez dit Nutella ?
Le prénom « Nutella » est contraire à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il correspond au nom commercial d’une pâte à tartiner et ne peut qu’entraîner des moqueries ou des réflexions désobligeantes.
Tribunal de grande instance de Valence, 30 novembre 2014
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
International
L’ONU se dote d’une nouvelle Politique de protection des données et de confidentialité
Le 13 mars 2024, le Secrétariat des Nations unies a publié un document intitulé « Politique de protection des données et de confidentialité » (PPDC). Attendu depuis longtemps, il répond à un besoin urgent de l’ONU d’organiser la protection des données traitées par l’Organisation, dont le volume ne cesse de croître. Une politique ambitieuse mais qui présente plusieurs limites.
Opinion
Le retour de la proportionnelle : entre stratégie politique et enjeux constitutionnels
Au nom d’une meilleure représentativité du paysage politique français, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, défend l’introduction d’une dose de proportionnelle aux prochaines élections législatives. Une proposition qui cache, en réalité, d’autres enjeux.
International
Pacte européen sur la migration et l’asile : ce qui va changer
Le Parlement européen vient d’adopter le « paquet migration et asile », un ensemble de textes remaniant en profondeur le droit de l’Union en la matière. Ces nouvelles dispositions seront définitivement adoptées par le Conseil avant les élections européennes des 6 et 7 juin prochains. Mais que disent-elles ?
International
Livraison d’armes à Israël : ce que dit le droit
Le 19 mars 2024, les ONG Human Rights Watch et Oxfam ont publié un rapport documentant la façon dont Israël utiliserait des armes américaines pour commettre des violations du droit international humanitaire dans la bande de Gaza. Elles demandent notamment au gouvernement américain de cesser de livrer des armes à Israël. Cette mobilisation des ONG amène à se questionner sur le cadre juridique applicable au commerce international des armes et sur la façon dont il peut être mobilisé en cas de violation.
Opinion
Prix planchers agricoles : les plafonds d’une telle proposition
La récente crise agricole a remis sur le devant de la scène politique la question des revenus des agriculteurs. Au point qu’au Salon international de l’agriculture, le président de la République a dit plaider pour l’instauration de « prix planchers ». Une proposition de loi écologiste, adoptée à l’Assemblée en première lecture, le prend au mot en décidant l’instauration de prix minimaux sur les matières agricoles dans le but de garantir un revenu digne aux producteurs.
Droit et justice
Jeux Olympiques 2024 : le droit du travail a tout prévu
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été, à Paris, mais aussi sur l’ensemble du territoire, sont lourds de conséquences pour l’organisation du travail de nombreuses entreprises. Retour sur quelques outils du droit du travail susceptibles d’être mobilisés.
Justice
Pourquoi une nouvelle directive sur la protection pénale de l’environnement ?
Le 27 février 2024, le Parlement européen a arrêté sa position concernant la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE. Le Conseil l’a approuvé le 26 mars 2024, celle-ci entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres auront alors deux ans pour la transposer dans leur système national.
Justice
Résolution sur le massacre du 17 octobre 1961 : une première pour un crime français
Le 28 mars 2024, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n° 273 relative à la reconnaissance et à la condamnation du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Fruit de négociations avec la présidence de la République, le texte, porté par la députée écologiste Sabrina Sebaihi, condamne la répression sanglante des Algériens commise sous l’autorité du préfet de police Maurice Papon et rend hommage à toutes les victimes et à leurs familles. Dans ses autres dispositions, la résolution souhaite l’inscription d’une journée de commémoration et un rapprochement mémoriel entre la France et l’Algérie. Mais qu’en attendre concrètement ?