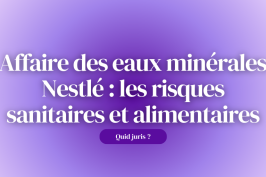Société
Mort de Shemseddine : le droit face à un ordre extra-étatique
Au-delà de l’émotion, le décès à Viry-Châtillon de Shemseddine, 15 ans, battu à mort par quatre individus qui disaient vouloir « préserver la réputation » d’une jeune fille, met en lumière l’existence d’un ordre extra-étatique, en l’occurrence un supposé « code d’honneur », qui imposerait ses propres normes et règles.
International
Israël/Iran : premier ou unique épisode d’un conflit interétatique ?
Dans la nuit du 13 au 14 avril, l’Iran tirait vers Israël plus de trois cents drones et missiles balistiques. Cette attaque inédite répond à celle menée le 1er avril par Israël contre le consulat iranien à Damas. Comment ces événements sont-ils appréhendés par le droit international ?
International
Les premiers arrêts « climat » : une climatisation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Le 9 avril dernier, la Cour a rendu trois arrêts dans trois affaires « climat ». La première était portée contre la Suisse par l’association aînées pour le climat et quatre adhérentes de l’association. La seconde, qui concernait la France, était portée par Damien Carême, ancien habitant et maire de la commune de Grande-Synthe. La troisième avait été initiée par six jeunes ressortissants portugais contre le Portugal et trente-deux autres États.
Opinion
Loi agricole : le Conseil constitutionnel, juge de la qualité des études d’impact
Le 22 avril 2024, le Conseil constitutionnel a considéré que l’étude d’impact du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ne méconnaissait pas les exigences fixées par la loi organique du 15 avril 2009. C’est l’occasion d’examiner une voie de recours encore relativement méconnue, censée faire du Conseil constitutionnel le garant de la qualité des études d’impact des projets de loi.
En bref
26 avril 202415:37
La Commission européenne impose des règles renforcées à SHEIN
25 avril 2024
La Défenseure des droits dénonce des refoulements illégaux de migrants à la frontière franco-italienne
24 avril 2024
Affaire Fillon : L’ancien Premier ministre définitivement jugé coupable par la Cour de cassation, un nouveau procès aura lieu pour les peines
24 avril 2024
Le Parlement européen adopte une loi imposant un « devoir de vigilance » à certaines entreprises
23 avril 2024
Le Conseil constitutionnel autorise l’examen parlementaire de la loi d’orientation agricole
Curiosis
En quête de liberté
Est condamné à quatre ans et demi de prison avec sursis le prêtre qui détourne l’argent de la quête pour s’acheter 19 voitures.
Lisbonne, Portugal, 6 mai 2021
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
Droit et justice
Sécurisation et régulation de l’espace numérique : une loi et après ?
Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (dit SREN) a enfin été adopté le 10 avril 2024, au terme d’une longue procédure parlementaire. Un doute demeure cependant, ou plutôt deux difficultés : une difficulté à court terme d’abord, relative à une possible censure à venir du Conseil constitutionnel. Une difficulté à moyen et long terme ensuite, intrinsèque aux difficultés de mise en œuvre technique de certaines solutions proposées.
International
La CEDH condamne la Suisse : tsunami climatique européen ou simple tempête ?
Les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 avril 2024 à propos des obligations des États en matière climatique resteront dans l’histoire ! C’est la première fois qu’une juridiction de cette importance consacre clairement une telle obligation à l’égard des États, ce qui la conduit à condamner la Suisse à la suite de la requête formée par une association « Aînées pour la protection du climat » réunissant plus de 2500 citoyennes suisses de plus de 64 ans poursuivant l’État helvète pour son inaction climatique et les effets induits sur leurs conditions de vie et de santé.
Opinion
Créer une « carte de famille monoparentale » : pour quoi faire ?
Un rapport d’information, rendu le 28 mars dernier au nom de la délégation au droit des femmes par les sénatrices Colombe Brossel et Béatrice Gosselin, préconise la reconnaissance d’un statut pour les familles monoparentales et la création, à titre expérimental, d’une « carte de famille monoparentale ». Objectif : que les parents concernés se signalent auprès de leurs interlocuteurs publics comme privés pour bénéficier de mesures sociales et fiscales destinées à prendre en compte leurs difficultés. Mais la création de ce statut est-il possible et souhaitable ?
International
Justice climatique : le procès en appel de Shell que tout le monde attend
Le géant pétrolier Shell a fait appel de la décision du tribunal de District de La Haye du 26 mai 2021 lui enjoignant de réduire de 45% ses émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 2019. Un procès absolument essentiel pour l’évolution de la justice climatique.
Collectivités et territoires
Autonomie de la Corse : un problème de méthode
L’actualité constitutionnelle relative aux différentes collectivités territoriales connaît une accélération surprenante en cette année 2024. Après l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, la vingt-sixième révision de la Constitution pourrait être celle intéressant l’élargissement du corps électoral appelé à voter aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Pourrait ensuite lui succéder un nouveau statut constitutionnel pour la Corse.
Société
Responsabilité civile et troubles de voisinage : quand le malheur des uns fait le bonheur des autres !
Un nouvel article dans le Code civil consacre le principe d’une responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage. Une responsabilité déconnectée de toute idée de faute où seule compte l’existence d’un trouble anormal excédant la gêne normalement attendue dans les rapports de voisinage. Bonne nouvelle : les néo-ruraux ne pourront plus se plaindre du chant du coq ! Une modification du droit qui, toutefois, n’est pas sans conséquence.
Société
Le licenciement dans la fonction publique : un tabou, vraiment ?
Le 9 avril, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a indiqué vouloir lever le « tabou du licenciement dans la fonction publique » notamment parce qu’il existe la garantie de l’emploi qui érigerait un obstacle statutaire au licenciement de fonctionnaires et agents publics. Le ministre a toutefois ajouté qu’il n’entendait pas revenir sur la garantie de l’emploi. Peut-on licencier les fonctionnaires et comment ? Les agents publics bénéficient-ils d’une garantie de l’emploi trop protectrice ?