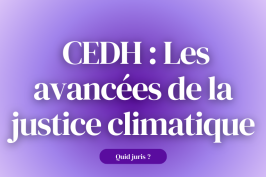Opinion
Créer une « carte de famille monoparentale » : pour quoi faire ?
Un rapport d’information, rendu le 28 mars dernier au nom de la délégation au droit des femmes par les sénatrices Colombe Brossel et Béatrice Gosselin, préconise la reconnaissance d’un statut pour les familles monoparentales et la création, à titre expérimental, d’une « carte de famille monoparentale ». Objectif : que les parents concernés se signalent auprès de leurs interlocuteurs publics comme privés pour bénéficier de mesures sociales et fiscales destinées à prendre en compte leurs difficultés. Mais la création de ce statut est-il possible et souhaitable ?
International
Justice climatique : le procès en appel de Shell que tout le monde attend
Le géant pétrolier Shell a fait appel de la décision du tribunal de District de La Haye du 26 mai 2021 lui enjoignant de réduire de 45% ses émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 2019. Un procès absolument essentiel pour l’évolution de la justice climatique.
Droit et justice
Sécurisation et régulation de l’espace numérique : une loi et après ?
Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (dit SREN) a enfin été adopté le 10 avril 2024, au terme d’une longue procédure parlementaire. Un doute demeure cependant, ou plutôt deux difficultés : une difficulté à court terme d’abord, relative à une possible censure à venir du Conseil constitutionnel. Une difficulté à moyen et long terme ensuite, intrinsèque aux difficultés de mise en œuvre technique de certaines solutions proposées.
International
La CEDH condamne la Suisse : tsunami climatique européen ou simple tempête ?
Les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme le 9 avril 2024 à propos des obligations des États en matière climatique resteront dans l’histoire ! C’est la première fois qu’une juridiction de cette importance consacre clairement une telle obligation à l’égard des États, ce qui la conduit à condamner la Suisse à la suite de la requête formée par une association « Aînées pour la protection du climat » réunissant plus de 2500 citoyennes suisses de plus de 64 ans poursuivant l’État helvète pour son inaction climatique et les effets induits sur leurs conditions de vie et de santé.
Collectivités et territoires
Autonomie de la Corse : un problème de méthode
L’actualité constitutionnelle relative aux différentes collectivités territoriales connaît une accélération surprenante en cette année 2024. Après l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, la vingt-sixième révision de la Constitution pourrait être celle intéressant l’élargissement du corps électoral appelé à voter aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Pourrait ensuite lui succéder un nouveau statut constitutionnel pour la Corse.
En bref
18 avril 202414:42
Conditions de détention dans une prison de Normandie : La CEDH condamne la France
17 avril 2024
Le Parlement suisse vote l’interdiction des symboles extrémistes
15 avril 2024
Le premier procès pénal de Donald Trump s’ouvre à New York
11 avril 2024
RIP sur l’immigration : Les Républicains voient leur demande rejetée par le Conseil constitutitonnel
11 avril 2024
Le projet de loi sur l’aide à mourir présenté en Conseil des ministres
Curiosis
Pas de quoi en faire une tartine
Il est un principe fondamental du droit anglo-américain que l’on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre.
Cour d’appel des Etats-Unis, (Circuit du District de Colombia, Washington D.C), 16 décembre 2003, IT Consultants, Inc. c/ République du Pakistan
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
International
Livraison d’armes à Israël : ce que dit le droit
Le 19 mars 2024, les ONG Human Rights Watch et Oxfam ont publié un rapport documentant la façon dont Israël utiliserait des armes américaines pour commettre des violations du droit international humanitaire dans la bande de Gaza. Elles demandent notamment au gouvernement américain de cesser de livrer des armes à Israël. Cette mobilisation des ONG amène à se questionner sur le cadre juridique applicable au commerce international des armes et sur la façon dont il peut être mobilisé en cas de violation.
Opinion
Prix planchers agricoles : les plafonds d’une telle proposition
La récente crise agricole a remis sur le devant de la scène politique la question des revenus des agriculteurs. Au point qu’au Salon international de l’agriculture, le président de la République a dit plaider pour l’instauration de « prix planchers ». Une proposition de loi écologiste, adoptée à l’Assemblée en première lecture, le prend au mot en décidant l’instauration de prix minimaux sur les matières agricoles dans le but de garantir un revenu digne aux producteurs.
Droit et justice
Jeux Olympiques 2024 : le droit du travail a tout prévu
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été, à Paris, mais aussi sur l’ensemble du territoire, sont lourds de conséquences pour l’organisation du travail de nombreuses entreprises. Retour sur quelques outils du droit du travail susceptibles d’être mobilisés.
Justice
Pourquoi une nouvelle directive sur la protection pénale de l’environnement ?
Le 27 février 2024, le Parlement européen a arrêté sa position concernant la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE. Le Conseil l’a approuvé le 26 mars 2024, celle-ci entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les États membres auront alors deux ans pour la transposer dans leur système national.
Justice
Résolution sur le massacre du 17 octobre 1961 : une première pour un crime français
Le 28 mars 2024, l’Assemblée nationale a adopté la résolution n° 273 relative à la reconnaissance et à la condamnation du massacre des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Fruit de négociations avec la présidence de la République, le texte, porté par la députée écologiste Sabrina Sebaihi, condamne la répression sanglante des Algériens commise sous l’autorité du préfet de police Maurice Papon et rend hommage à toutes les victimes et à leurs familles. Dans ses autres dispositions, la résolution souhaite l’inscription d’une journée de commémoration et un rapprochement mémoriel entre la France et l’Algérie. Mais qu’en attendre concrètement ?
Justice
Directive sur la transparence des salaires : de vrais changements… en 2026
La directive 2023/970 du 10 mai 2023 « visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes » a pour principal objectif de permettre la mise en évidence d’éventuels écarts de salaires pour mieux y remédier. Elle doit être transposée dans le droit français en 2026 et il y a fort à parier que les apports de ce texte ne demeureront pas cantonnés à la seule égalité salariale.
Société
Transports ferroviaire : la concurrence fait-elle vraiment baisser les prix ?
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs en France est-elle synonyme de baisse des prix des billets pour les clients comme semblent le suggérer les premiers effets de la concurrence sur la ligne grande vitesse Paris / Lyon dont les prix ont diminué de 10% en 2022 depuis l’arrivée de Trenitalia ? (V. Rapport sur le marché français du transport ferroviaire de l’ART pour 2022). Les usagers-clients l’attendent face à des tarifs qu’ils jugent trop élevés mais aussi opaques et complexes.