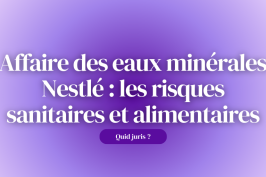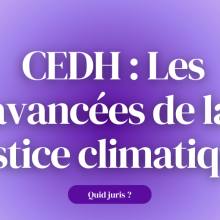Droit et justice
Interdiction d’une réunion LFI à l’Université de Lille : ni nouveau, ni choquant !
Le mercredi 17 avril 2024, l’Université de Lille a décidé d’annuler, la veille de sa tenue, une réunion préalablement autorisée qui devait être organisée par une association d’étudiants pro-palestinienne. Cette réunion devait accueillir le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et Rima Hassam, une militante d’origine palestinienne et de nationalité française, classée 7e sur la liste de LFI aux élections européennes. Que dit le droit ?
Droit et justice
424 projets d’envergure nationale et européenne : seul le ZAN ne change pas d’avis ?
L’objectif « Zéro artificialisation nette » (ZAN) suscite bon nombre de critiques. Il provoque l’inquiétude voire l’hostilité d’élus locaux et de parlementaires. Certains le qualifient de « ruralicide » en ce qu’il empêcherait les petites communes de pouvoir se développer ; d’autres jugent qu’il est un obstacle à la lutte contre la crise du logement et qu’il une ruée vers un nouvel or « foncier ». À peine l’a-t-il reconnu avec la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 que le législateur en a revu les contours en sortant les projets d’envergure nationale et européenne (PENE) de la comptabilisation des surfaces artificialisées. Le dernier acte de ces assouplissements correspond à la consultation ouverte par le ministère de la transition écologique sur le projet d’arrêté fixant les 424 projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur entraînant une artificialisation des sols prévu par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023.
Droit et justice
La surpopulation carcérale : une fatalité ?
La France connaît, depuis de nombreuses années, un état de surpopulation carcérale mais les signaux récents s’avèrent pour le moins inquiétants. Le nombre de détenus s’inscrit dans une aspiration ascendante – si on excepte la baisse conjoncturelle liée au confinement durant la pandémie du Covid 19 – qui ne semble pas contenue. Les chiffres sont éloquents : 76 766 personnes détenues dans les prisons françaises pour 61 629 places opérationnelles (sources statistiques des établissements et des personnes écrouées en France au 1er mars 2024, Ministère de la Justice). Un record absolu. En un an, la population carcérale a augmenté de 6,1%. 3 099 détenus dormaient sur un matelas au sol (en augmentation de 53 %). 12 établissements ou quartiers ont une densité carcérale supérieure ou égale à 200 %. Une telle situation s’accorde-t-elle avec le respect de la dignité humaine ?
Droit et justice
Gabriel Attal et le « sursaut d’autorité » : faut-il traiter les mineurs délinquants comme des majeurs ?
Dans le prolongement de l’émotion suscitée par des faits divers récents impliquant des mineurs, le Premier Ministre a annoncé avoir demandé au ministre de la Justice de réfléchir à la question de la majorité pénale autour de deux questions : pouvoir envoyer les jeunes de plus de 16 ans en comparution immédiate s’ils ont commis des délits, comme les jeunes majeurs, et pouvoir atténuer l’excuse de minorité accordée aux mineurs impliqués dans des faits de délinquance. Plus largement, faut-il réformer le droit pénal des mineurs ?
Droit et justice
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 : le dopage du droit de l’urbanisme à coups de dérogations
Le 13 septembre 2017, Paris s’est vue attribuée les Jeux Olympiques et Paralympiques de juillet 2024. Même si cette candidature reposait sur l’existence d’un grand nombre des équipements nécessaires à cet événement, des constructions étaient malgré tout nécessaires (village olympique, centre aquatique, Arena de la Porte de la Chapelle…). Or, Paris ne disposait que de 6 ans pour que tout soit prêt le 26 juillet 2024. Pour faire face à ce défi, par la loi n°2018-202 du 26 mars 2018, le Parlement a facilité la tâche de la ville de Paris en dopant le droit de l’urbanisme, à coups de dérogations.
En bref
24 avril 202414:56
Affaire Fillon : L’ancien Premier ministre définitivement jugé coupable par la Cour de cassation, un nouveau procès aura lieu pour les peines
24 avril 202414:34
Le Parlement européen adopte une loi imposant un « devoir de vigilance » à certaines entreprises
23 avril 2024
Le Conseil constitutionnel autorise l’examen parlementaire de la loi d’orientation agricole
19 avril 2024
Lutte contre la criminalité organisée : Un parquet national dévolu ?
18 avril 2024
Conditions de détention dans une prison de Normandie : La CEDH condamne la France
Curiosis
Droit du travail et bataille de boules de neige
Ne commet pas de faute l’employeur qui ne prend pas de mesures afin d’éviter que son salarié sourd ne soit blessé par un collègue malvoyant durant une bataille de boules de neige.
Cour d’appel de Paris, 4 décembre 2008, n°07/01014
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
Société
Responsabilité civile et troubles de voisinage : quand le malheur des uns fait le bonheur des autres !
Un nouvel article dans le Code civil consacre le principe d’une responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage. Une responsabilité déconnectée de toute idée de faute où seule compte l’existence d’un trouble anormal excédant la gêne normalement attendue dans les rapports de voisinage. Bonne nouvelle : les néo-ruraux ne pourront plus se plaindre du chant du coq ! Une modification du droit qui, toutefois, n’est pas sans conséquence.
Société
Le licenciement dans la fonction publique : un tabou, vraiment ?
Le 9 avril, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a indiqué vouloir lever le « tabou du licenciement dans la fonction publique » notamment parce qu’il existe la garantie de l’emploi qui érigerait un obstacle statutaire au licenciement de fonctionnaires et agents publics. Le ministre a toutefois ajouté qu’il n’entendait pas revenir sur la garantie de l’emploi. Peut-on licencier les fonctionnaires et comment ? Les agents publics bénéficient-ils d’une garantie de l’emploi trop protectrice ?
Justice
Pourquoi Le référendum sur l’accès des étrangers aux prestations sociales n’aura pas lieu
Le 12 mars 2024, la Présidence de l’Assemblée nationale, en application de l’article 11 de la Constitution, a enregistré la proposition de loi n°2324 visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, déposée par 190 parlementaires, majoritairement LR. C’est la sixième fois que la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP) est activée depuis son entrée en vigueur en 2015. C’est la sixième fois, ce 11 avril, que la tentative se solde par un échec devant le Conseil constitutionnel. Retour sur une défaite politique.
International
L’ONU se dote d’une nouvelle Politique de protection des données et de confidentialité
Le 13 mars 2024, le Secrétariat des Nations unies a publié un document intitulé « Politique de protection des données et de confidentialité » (PPDC). Attendu depuis longtemps, il répond à un besoin urgent de l’ONU d’organiser la protection des données traitées par l’Organisation, dont le volume ne cesse de croître. Une politique ambitieuse mais qui présente plusieurs limites.
Opinion
Le retour de la proportionnelle : entre stratégie politique et enjeux constitutionnels
Au nom d’une meilleure représentativité du paysage politique français, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, défend l’introduction d’une dose de proportionnelle aux prochaines élections législatives. Une proposition qui cache, en réalité, d’autres enjeux.
International
Pacte européen sur la migration et l’asile : ce qui va changer
Le Parlement européen vient d’adopter le « paquet migration et asile », un ensemble de textes remaniant en profondeur le droit de l’Union en la matière. Ces nouvelles dispositions seront définitivement adoptées par le Conseil avant les élections européennes des 6 et 7 juin prochains. Mais que disent-elles ?