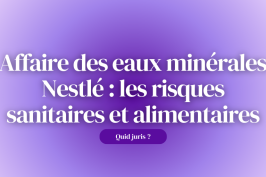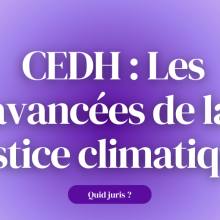Droit et justice
Gabriel Attal et le « sursaut d’autorité » : faut-il traiter les mineurs délinquants comme des majeurs ?
Dans le prolongement de l’émotion suscitée par des faits divers récents impliquant des mineurs, le Premier Ministre a annoncé avoir demandé au ministre de la Justice de réfléchir à la question de la majorité pénale autour de deux questions : pouvoir envoyer les jeunes de plus de 16 ans en comparution immédiate s’ils ont commis des délits, comme les jeunes majeurs, et pouvoir atténuer l’excuse de minorité accordée aux mineurs impliqués dans des faits de délinquance. Plus largement, faut-il réformer le droit pénal des mineurs ?
Droit et justice
Interdiction d’une réunion LFI à l’Université de Lille : ni nouveau, ni choquant !
Le mercredi 17 avril 2024, l’Université de Lille a décidé d’annuler, la veille de sa tenue, une réunion préalablement autorisée qui devait être organisée par une association d’étudiants pro-palestinienne. Cette réunion devait accueillir le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et Rima Hassam, une militante d’origine palestinienne et de nationalité française, classée 7e sur la liste de LFI aux élections européennes. Que dit le droit ?
Opinion
Loi agricole : le Conseil constitutionnel, juge de la qualité des études d’impact.
Le 22 avril 2024, le Conseil constitutionnel a considéré que l’étude d’impact du projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture ne méconnaissait pas les exigences fixées par la loi organique du 15 avril 2009. C’est l’occasion d’examiner une voie de recours encore relativement méconnue, censée faire du Conseil constitutionnel le garant de la qualité des études d’impact des projets de loi.
Droit et justice
La surpopulation carcérale : une fatalité ?
La France connaît depuis longtemps un état de surpopulation carcérale mais les signaux récents s’avèrent inquiétants : 76 766 personnes détenues dans les prisons françaises (record absolu) pour 61 629 places opérationnelles. + 6,1% en un an. 3 099 détenus dorment sur un matelas au sol (en augmentation de 53 %). 12 établissements ou quartiers ont une densité carcérale supérieure ou égale à 200 %. Une telle situation s’accorde-t-elle avec le respect de la dignité humaine ?
Droit et justice
424 projets d’envergure nationale et européenne : seul le ZAN ne change pas d’avis ?
Malgré la reconnaissance par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 d’un objectif « Zéro artificialisation nette », le législateur en a revu les contours en excluant les projets d’envergure nationale et européenne de la comptabilisation des surfaces artificialisées. Le dernier acte de ces assouplissements correspond à la consultation ouverte par le ministère de la transition écologique sur le projet d’arrêté fixant les 424 projets d’envergure nationale ou européenne prévus par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023.
En bref
25 avril 202412:05
La Défenseure des droits dénonce des refoulements illégaux de migrants à la frontière franco-italienne
24 avril 2024
Affaire Fillon : L’ancien Premier ministre définitivement jugé coupable par la Cour de cassation, un nouveau procès aura lieu pour les peines
24 avril 2024
Le Parlement européen adopte une loi imposant un « devoir de vigilance » à certaines entreprises
23 avril 2024
Le Conseil constitutionnel autorise l’examen parlementaire de la loi d’orientation agricole
19 avril 2024
Lutte contre la criminalité organisée : Un parquet national dévolu ?
Curiosis
La Justice ne dort jamais
Est condamné à 14 mois de prison celui qui, afin de ne pas être jugé pour escroquerie, simule un coma pendant deux ans.
Tribunal de Swansea (Royaume-Uni), 8 décembre 2015
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
Collectivités et territoires
Autonomie de la Corse : un problème de méthode
L’actualité constitutionnelle relative aux différentes collectivités territoriales connaît une accélération surprenante en cette année 2024. Après l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, la vingt-sixième révision de la Constitution pourrait être celle intéressant l’élargissement du corps électoral appelé à voter aux élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Pourrait ensuite lui succéder un nouveau statut constitutionnel pour la Corse.
Société
Responsabilité civile et troubles de voisinage : quand le malheur des uns fait le bonheur des autres !
Un nouvel article dans le Code civil consacre le principe d’une responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage. Une responsabilité déconnectée de toute idée de faute où seule compte l’existence d’un trouble anormal excédant la gêne normalement attendue dans les rapports de voisinage. Bonne nouvelle : les néo-ruraux ne pourront plus se plaindre du chant du coq ! Une modification du droit qui, toutefois, n’est pas sans conséquence.
Société
Le licenciement dans la fonction publique : un tabou, vraiment ?
Le 9 avril, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a indiqué vouloir lever le « tabou du licenciement dans la fonction publique » notamment parce qu’il existe la garantie de l’emploi qui érigerait un obstacle statutaire au licenciement de fonctionnaires et agents publics. Le ministre a toutefois ajouté qu’il n’entendait pas revenir sur la garantie de l’emploi. Peut-on licencier les fonctionnaires et comment ? Les agents publics bénéficient-ils d’une garantie de l’emploi trop protectrice ?
Justice
Pourquoi Le référendum sur l’accès des étrangers aux prestations sociales n’aura pas lieu
Le 12 mars 2024, la Présidence de l’Assemblée nationale, en application de l’article 11 de la Constitution, a enregistré la proposition de loi n°2324 visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, déposée par 190 parlementaires, majoritairement LR. C’est la sixième fois que la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP) est activée depuis son entrée en vigueur en 2015. C’est la sixième fois, ce 11 avril, que la tentative se solde par un échec devant le Conseil constitutionnel. Retour sur une défaite politique.
International
L’ONU se dote d’une nouvelle Politique de protection des données et de confidentialité
Le 13 mars 2024, le Secrétariat des Nations unies a publié un document intitulé « Politique de protection des données et de confidentialité » (PPDC). Attendu depuis longtemps, il répond à un besoin urgent de l’ONU d’organiser la protection des données traitées par l’Organisation, dont le volume ne cesse de croître. Une politique ambitieuse mais qui présente plusieurs limites.
Opinion
Le retour de la proportionnelle : entre stratégie politique et enjeux constitutionnels
Au nom d’une meilleure représentativité du paysage politique français, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, défend l’introduction d’une dose de proportionnelle aux prochaines élections législatives. Une proposition qui cache, en réalité, d’autres enjeux.