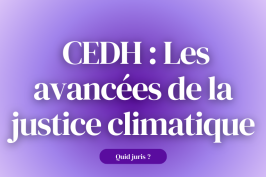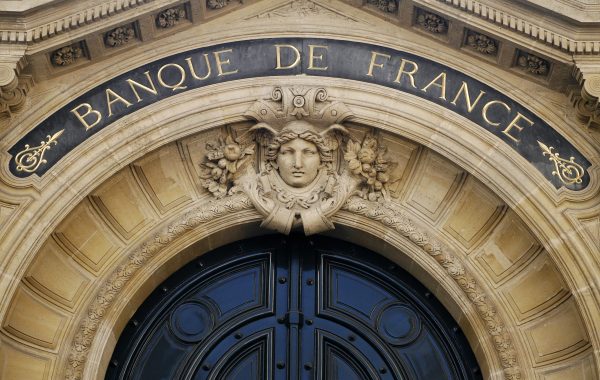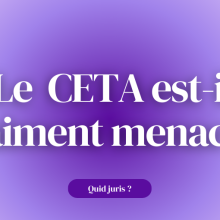Société
Le licenciement dans la fonction publique : un tabou, vraiment ?
Le 9 avril, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a indiqué vouloir lever le « tabou du licenciement dans la fonction publique » notamment parce qu’il existe la garantie de l’emploi qui érigerait un obstacle statutaire au licenciement de fonctionnaires et agents publics. Le ministre a toutefois ajouté qu’il n’entendait pas revenir sur la garantie de l’emploi. Peut-on licencier les fonctionnaires et comment ? Les agents publics bénéficient-ils d’une garantie de l’emploi trop protectrice ?
Société
Responsabilité civile et troubles de voisinage : quand le malheur des uns fait le bonheur des autres !
Un nouvel article dans le Code civil consacre le principe d’une responsabilité objective pour troubles anormaux de voisinage. Une responsabilité déconnectée de toute idée de faute où seul compte l’existence d’un trouble anormal excédant la gêne normalement attendue dans les rapports de voisinage. Bonne nouvelle : les néo-ruraux ne pourront plus se plaindre du chant du coq ! Une modification du droit qui, toutefois, n’est pas sans conséquence.
Justice
Pourquoi Le référendum sur l’accès des étrangers aux prestations sociales n’aura pas lieu
Le 12 mars 2024, la Présidence de l’Assemblée nationale, en application de l’article 11 de la Constitution, a enregistré la proposition de loi n°2324 visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, déposée par 190 parlementaires, majoritairement LR. C’est la sixième fois que la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP) est activée depuis son entrée en vigueur en 2015. C’est la sixième fois, ce 11 avril, que la tentative se solde par un échec devant le Conseil constitutionnel. Retour sur une défaite politique.
En bref
15 avril 202414:11
Le premier procès pénal de Donald Trump s’ouvre à New York
11 avril 2024
RIP sur l’immigration : Les Républicains voient leur demande rejetée par le Conseil constitutitonnel
11 avril 2024
Le projet de loi sur l’aide à mourir présenté en Conseil des ministres hier
9 avril 2024
Jugement historique : La Suisse est condamnée par la CEDH pour inaction climatique
4 avril 2024
Selon une étude, plus des trois quarts des violences sexuelles seraient classées sans suite
Curiosis
Pas sorti de l’auberge
Est placé en détention provisoire l’homme ayant rajouté des flèches au sol chez IKEA, créant ainsi un labyrinthe dont les clients n’arrivaient plus à trouver la sortie.
Parquet d’Atlanta (USA), 01 avril 2018
Tiktok
Le droit décrypté en vidéo
Justice
Directive sur la transparence des salaires : de vrais changements… en 2026
La directive 2023/970 du 10 mai 2023 « visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes » a pour principal objectif de permettre la mise en évidence d’éventuels écarts de salaires pour mieux y remédier. Elle doit être transposée dans le droit français en 2026 et il y a fort à parier que les apports de ce texte ne demeureront pas cantonnés à la seule égalité salariale.
Société
Transports ferroviaire : la concurrence fait-elle vraiment baisser les prix ?
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs en France est-elle synonyme de baisse des prix des billets pour les clients comme semblent le suggérer les premiers effets de la concurrence sur la ligne grande vitesse Paris / Lyon dont les prix ont diminué de 10% en 2022 depuis l’arrivée de Trenitalia ? (V. Rapport sur le marché français du transport ferroviaire de l’ART pour 2022). Les usagers-clients l’attendent face à des tarifs qu’ils jugent trop élevés mais aussi opaques et complexes.
Opinion
Nouvelle Calédonie : le temps du tocsin
Le 2 avril 2024, le Sénat a adopté le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Le texte va maintenant être examiné à l’Assemblée, le gouvernement espérant pouvoir convoquer le Congrès du Parlement au début de l’été.
International
Le sort de l’Ukraine dépend-il des élections européennes ?
Chaque élection européenne soulève d’une part la question de la répartition des compétences entre l’Union et ses Etats membres et d’autre part celle de l’exercice des compétences européennes par les institutions politiques de l’Union (Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l’Union et Commission). A cet égard, la mention de l’Ukraine dans le débat européen appelle une triple distinction.
Justice
Se nourrir : une activité quotidienne à haut risque ?
Après les lasagnes au cheval, la poudre de lait ou les pizzas surgelées, c’est l’eau en bouteille qui défraie la chronique en ce début d’année. Une enquête a été ouverte contre des industriels pour tromperie suite au recours à des traitements interdits sur des eaux minérales supposément naturelles. Les crises alimentaires reviennent régulièrement sur le devant de la scène médiatique. Scandaleuses lorsqu’elles sont le fruit de fraudes, parfois même meurtrières, elles sont plus généralement une hantise quotidienne pour les exploitants du secteur qui sont tenus de prévenir les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. Comment le droit organise-t-il la protection du consommateur face à ces risques ?
Justice
L’agriculture, « intérêt général majeur » de la Nation : ça change quoi ?
Lors de sa visite du Salon de l’agriculture, Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l’agriculture comme un « intérêt général majeur de la Nation ». A cet effet, le projet de loi d’orientation agricole crée un nouvel article du Code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé : « L’agriculture, la pêche, l’aquaculture et l’alimentation sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire qui contribue à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Quels peuvent être les effets d’une telle reconnaissance ?